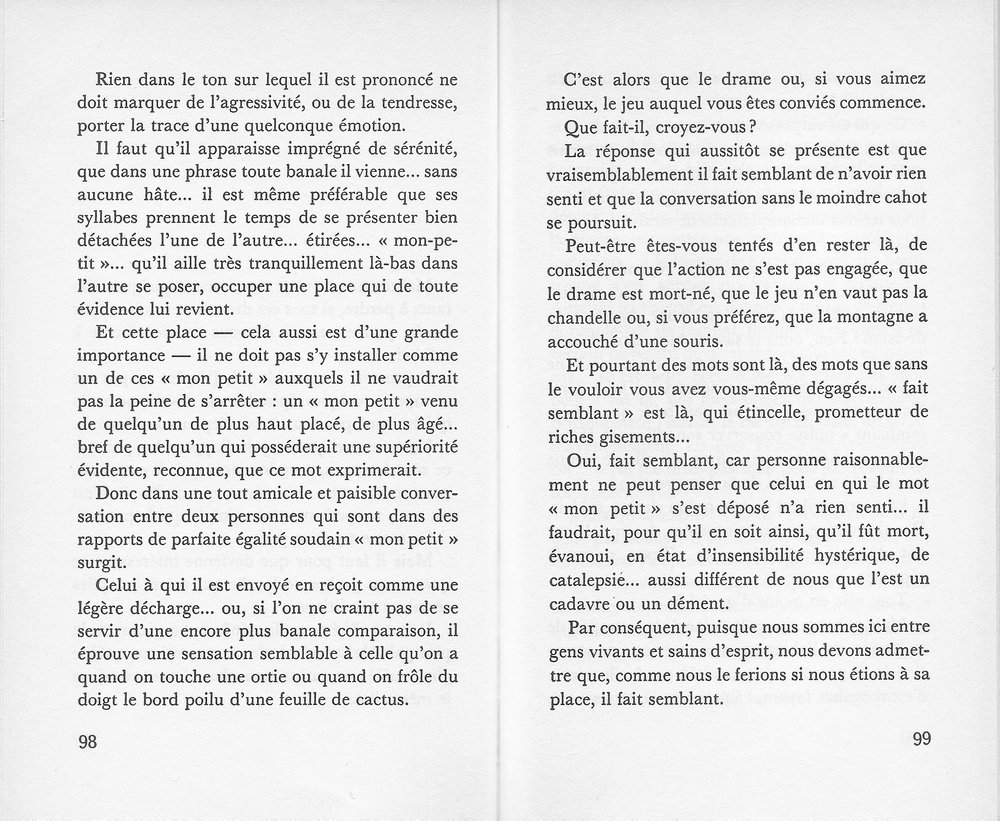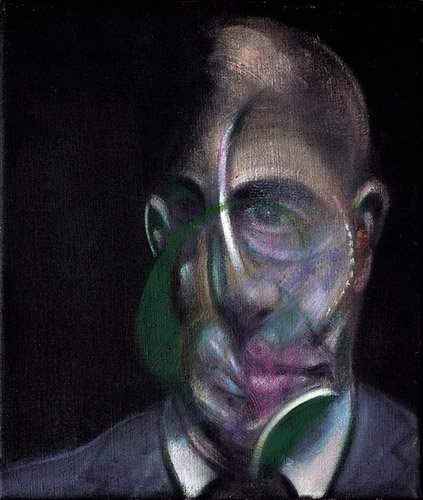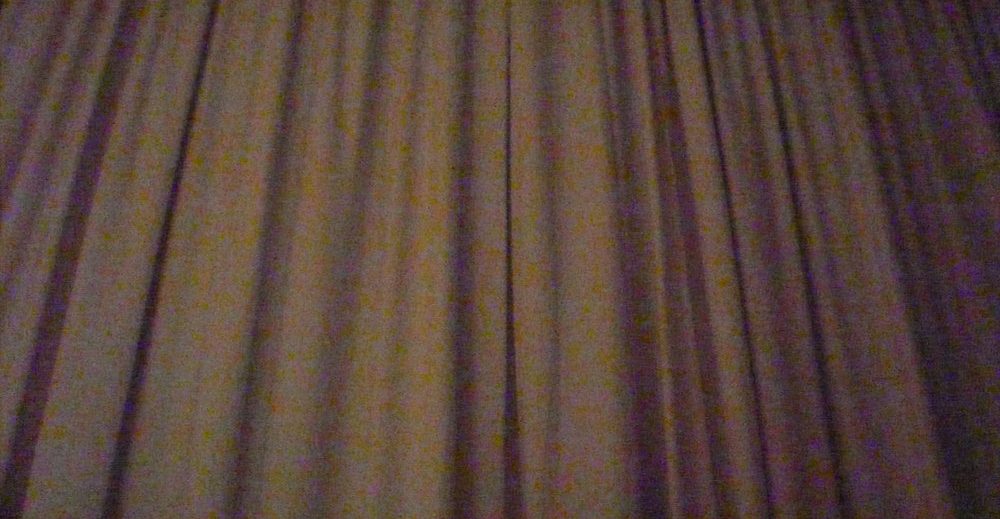Histoire sans noms
Texte de « L’usage de la parole » de Nathalie Sarraute, 1980.
« L’admiration n’a rien à voir avec le respect »
Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né.
Y a-t-il « snobisme » à affirmer que l’on admire froidement, « techniquement », un écrivain reconnu (disons entré dans l’Histoire de la littérature, même de fraîche date) sans en être personnellement, affectivement touché ? Question troublante, que je me pose pour moi-même, indécis et même circonspect quant à la réponse à lui donner. C’est la lecture récente (donc tardive pour ce qui me concerne…) de Nathalie Sarraute, je crois, qui l’a déclenchée. Mais ce déclenchement n’a pu lui-même se produire que par contraste avec des lectures antécédentes, tout au long de ma vie, d’autres auteurs. Je suis resté froid, extérieur, étranger à ce que je lisais, à ce que cette œuvre voulait me « raconter » (à l’exception de quelques rares et fugitifs moments où une sorte de mystérieuse connexion directe, personnelle, s’établissait), mais je reconnaissais ou croyais reconnaître un authentique talent d’écrivain, une technique éprouvée, une esthétique, etc. Contraste donc avec ceux que j’appelle mes écrivains-frères, ceux dont la lecture de l’œuvre à laquelle j’ai pu procéder, quelque soit l’âge de ma vie où elle est arrivée, m’ont immédiatement et continûment donné un sentiment de fraternité, d’intimité, d’intériorité (comme si c’était « moi » que je lisais à travers une expression parfaite, limpide, essentielle), bien au-delà de l’admiration esthétique ou littéraire qu’ils m’inspiraient, s’inscrivant ainsi en moi comme des sortes de « compagnons de route », ou des « frères d’armes », des amis et alliés indéfectibles avec qui, et en un sens grâce à qui, je continuais de vivre. Je n’en dresse pas ici une liste exhaustive (quelle en serait d’ailleurs la pertinence, ne vaut-il pas mieux la laisser ouverte ?), cela me mènerait trop loin pour l’heure, mais – sans aucun inopportun esprit de « classement » : Baudelaire, Rabelais, Proust, Leiris, Nerval, Apollinaire, Barbey d’Aurevilly, Larbaud, Cioran, sont pour moi de ces écrivains-frères. Sans doute (du moins je l’espère pour une forme d’honnêteté ou de sincérité qu’il faut s’attacher à avoir et conserver avec soi-même) les aurais-je aimé comme je les aime si, commençant à les lire, je n’avais pas su qu’ils étaient de ces écrivains « entrés dans l’Histoire », figurant dans les manuels de littérature, etc. Concernant Nathalie Sarraute, je me pose donc la question : sachant qu’elle aussi est « entrée dans l’Histoire », et n’étant pas profondément sensible à son écriture mais seulement admiratif de son travail, cette admiration n’est-elle pas uniquement une sorte d’alibi intellectuel pour ne pas « désavouer » quitte à m’en rendre ridicule, son statut d’écrivain reconnu et porté aux nues par des tas de gens bien plus cultivés et connaisseurs que moi ? (d’où le soupçon – sans son « ère » – de snobisme invoqué dans la question liminaire). Question troublante, disais-je, car sensible, je crois, aux « faits de langage », ou tout simplement à la littérature sous toutes les formes qu’elle peut prendre, au-delà ou indépendamment du puissant et incomparable sentiment de fraternité que me donnent certains écrivains, je sais que mon admiration pour Nathalie Sarraute, aussi extérieure ou « objective » qu’elle soit, n’est pas une admiration factice, mais celle d’une sorte de « conscience sensible » de ce qui est, en matière d’écriture, beau, fort, réussi, de ce qui possède, en un mot, de la valeur. Mais il demeure en moi un sentiment d’ambiguïté sur ce point : quelle est la part, s’il en existe une, de conditionnement culturel et psychologique dans cette définition d’une admiration extérieure ou objective, comme s’il s’agissait à travers elle de rester dans la sphère (bien-pensante ?) de « ce qu’il faut aimer » ou au minimum admirer pour ne pas passer (auprès d’une « élite normative », pour parler vite) pour un con ? (je me fais d’ailleurs la réflexion au passage qu’une admiration véritable, totale, entièrement sincère pour l’œuvre d’un écrivain – comme pour celle de tout artiste – pourrait être définie par l’addition naturelle ou la coexistence harmonieuse d’une admiration extérieure et objective, purement esthétique si l’on veut, et d’une admiration intériorisée, subjective, fraternelle, venant naturellement par l’adhésion spontanée, personnelle, au langage de l’auteur, ou plutôt à l’esprit de ce langage). Aurais-je formé dans mon esprit ce qui ressemble un peu à une sorte de compromis d’admiration ou de reconnaissance d’une valeur si je n’avais pas su que sur la couverture du livre se trouvait inscrit le nom d’un écrivain unanimement reconnu, admiré, et qu’il est par conséquent impossible de ne pas reconnaître et admirer, sous peine de s’exclure de la Communion des saints de la Culture, et qu’en aurait-il été (qu’en serait-il d’ailleurs d’une manière générale) si aucun nom n’y avait figuré ? Faut-il toujours se fier, pour l’évaluation d’une œuvre, au sentiment de fraternité que sa lecture nous donne par voie directe, autrement dit, d’une certaine manière, à notre seule sensibilité ou affectivité immédiate ? Peut-être faudrait-il instaurer dans le domaine littéraire l’équivalent des « dégustations à l’aveugle » en œnologie : tu lis sans connaître le nom de l’auteur, sans savoir d’où il sort, s’il figure déjà dans les manuels, etc., donc sans le risque, si ce nom est déjà prestigieux et panthéonisé, de s’extasier à l’avance de façon à s’assurer de rester un bon petit soldat culturel dans l’armée anonyme mais stricte du bon goût obligatoire, et tu dois dire si selon toi, c’est du grand cru classé ou de la piquette… Ce qui ne serait peut-être pas sans rejoindre l’idée ou même l’idéal de Valéry selon lequel « l’histoire de la littérature pourrait se faire sans que le nom d’un écrivain y fût prononcé »…